L’IMD place la Suisse au 5ème rang mondial en matière de compétitivité digitale, derrière le Danemark ou les Etats-Unis mais gagnant une place en 2022. Pour la 11ème année consécutive, notre pays est également en tête du classement mondial de l’innovation, publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’OMPI. En guise de clin d’œil, on peut imaginer ce que certaines nations voisines et amies auraient fait avec un tel classement! En Suisse, pas de chant du coq. On sait rester modeste. Trop? Sans doute. Car si tous les indices placent la Suisse en tête du concert des nations, ce que nous ne disons pas assez c’est que nous sommes très menacés, en raison du manque cruel de personnels qualifiés. Et cela, particulièrement dans les domaines de la high tech. ELCA le sait, qui a 150 offres d’emploi ouvertes en ce moment.
Pour y remédier, il faut impérativement que pouvoirs publics et entreprises privées marchent main dans la main. J’ai eu l’occasion de le dire récemment, lors d’une manifestation organisée par le département valaisan de la formation et de l’économie du Conseiller d’État Christophe Darbellay. Le maintien du niveau d’excellence et de prospérité de ce pays dépendra de notre capacité à construire des ponts.
La chasse aux cerveaux
Avec plus de 100’000 places vacantes enregistrées au premier trimestre 2022, la pénurie de main-d’œuvre atteint des records en Suisse. Les difficultés de recrutement touchent aussi bien l’industrie que les services. Le Conseiller d’État Christophe Darbellay a relevé, lors de l’évènement de la foire du Valais, les besoins urgents d’apprentis et d’étudiants bien formés dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la santé, de la construction, de la logistique ou encore de l’artisanat du bâtiment. Et bien sûr dans le secteur des hautes technologies.
On le sait, la pandémie a donné un coup d’accélérateur à la digitalisation de l’économie et tous les secteurs sont désormais en concurrence acharnée pour attirer le même type de compétences. Je dirais même tous les pays développés, car la guerre est ouverte entre les Européens pour attirer les emplois à haut niveau de qualification. Pour l’heure, la Suisse avec ses salaires attractifs et ses Hautes Écoles, parmi les meilleures du monde, arrive encore à rester plus ou moins compétitive. Mais qu’en sera-t-il dans le futur? On connait les problèmes que font courir à la recherche, le fait de ne plus être dans le premier wagon du programme européen Horizon 2020. Et pour les jeunes générations, le salaire n’est qu’une des composantes du choix professionnel. La pénurie de cerveaux est à prendre très au sérieux, d’autant que selon «Employés Suisses», d’ici quatre ans, lorsque tous les babyboomers auront pris leur retraite, il manquera près de 365’000 travailleurs et travailleuses qualifiées avec un diplôme professionnel ou universitaire en Suisse.
Un relais privé-public
Accélérer la transformation de notre système de formation pour préparer nos prochaines générations à un monde différent, voilà l’une des pistes qui est suivie, notamment par le système d’éducation valaisan. Un dialogue et un échange plus fréquent, avec les milieux privés, pourraient rendre le processus plus efficace encore. La bascule numérique de la société est en marche et tous les secteurs sont désormais concernés, santé, prévoyance, professionnelle, finances, justice, énergie… Le secteur de la high tech va fournir de plus en plus d’emplois et demander de plus en plus de compétences. Il serait souhaitable de rendre la frontière entre formation et monde professionnel plus souple et fluide. La transformation numérique n’est pas qu’une affaire d’HES ou d’Epfl. L’école est un partenaire crucial de la digitalisation de la société. Les jeunes générations doivent comprendre l’intérêt pour eux, à devenir des acteurs de cette transition. Il serait intéressant à ce propos d’étudier plus profondément ce qui se fait de mieux ailleurs, particulièrement dans les pays nordiques. Comme le disait Darwin, ce n’est pas l’espèce la plus forte qui survit, ni la plus intelligente mais celle la plus réactive aux changements.


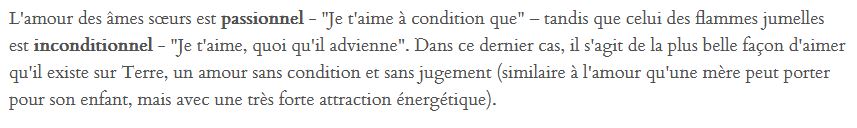
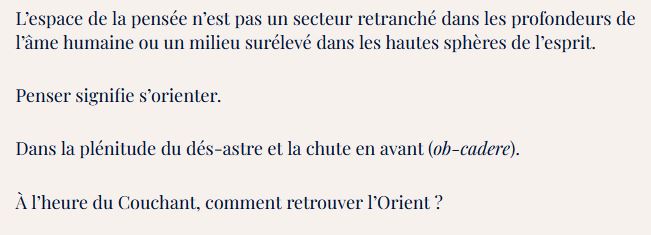
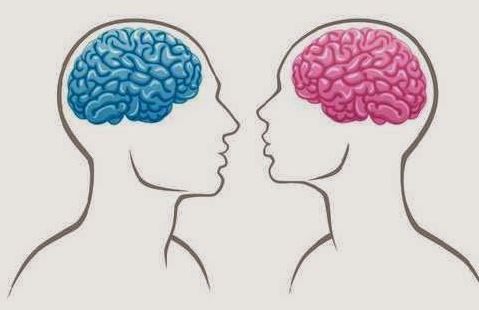

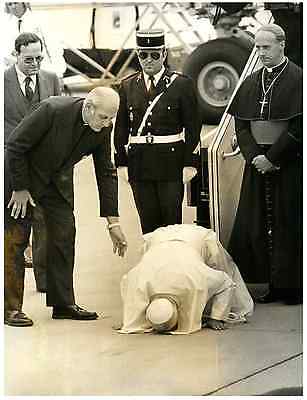




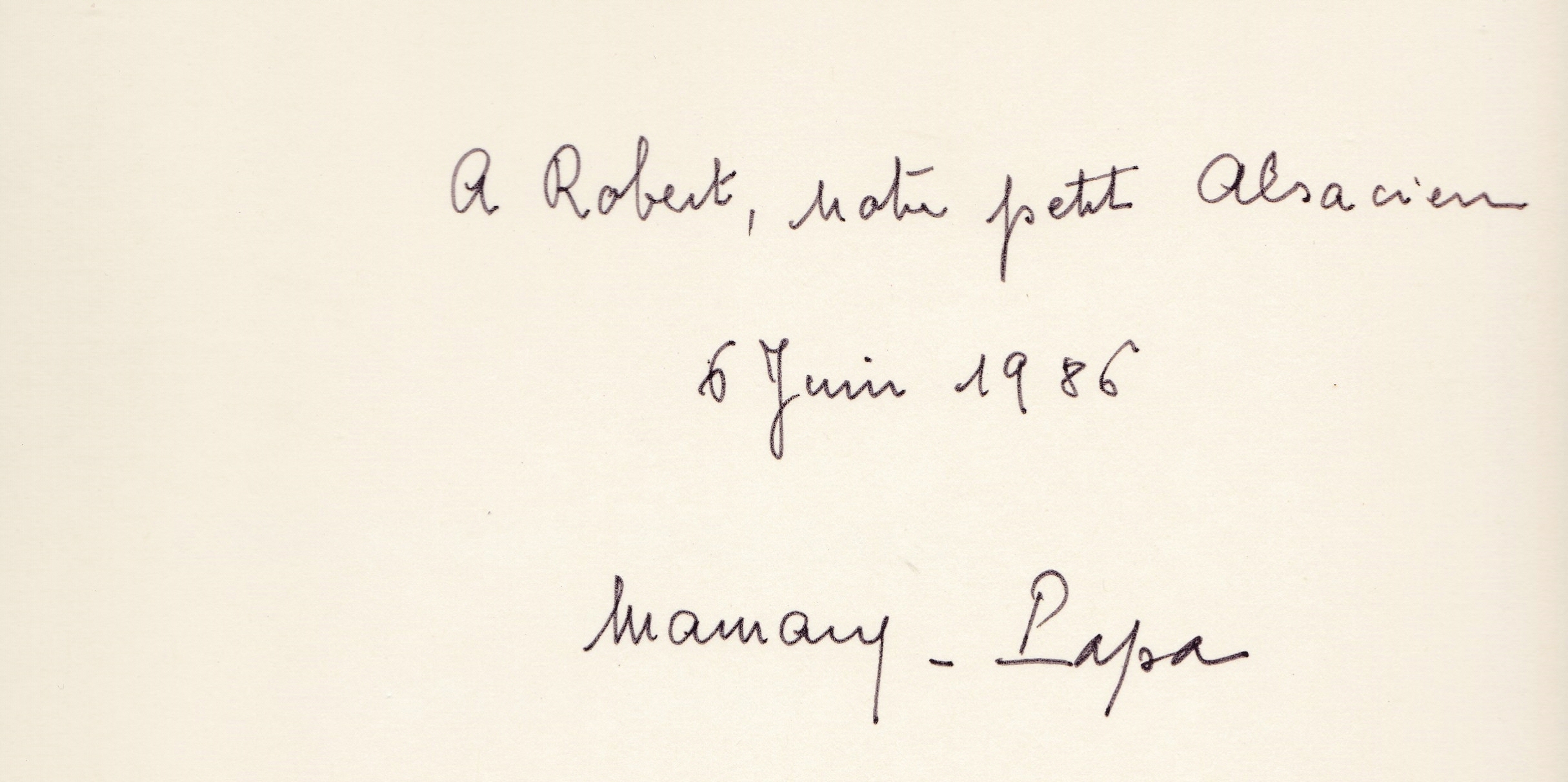
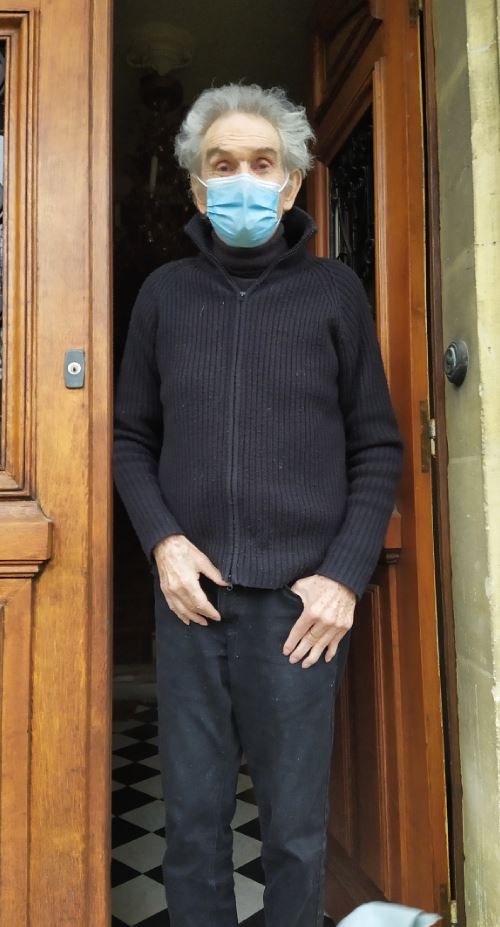





:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/IY6MGWTOIVETPEVMPVGQFY3TMM.jpg)
 https://video.lefigaro.fr/_next/static/image/src/assets/player/carton/wait-consent.294a9acde713b3443ad1a66edbd00006.jpg 750w,
https://video.lefigaro.fr/_next/static/image/src/assets/player/carton/wait-consent.294a9acde713b3443ad1a66edbd00006.jpg 750w, 

:quality(70):focal(1545x3115:1555x3125)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/BILP7OUPENBNRAUR7EXONJE75I.jpg)