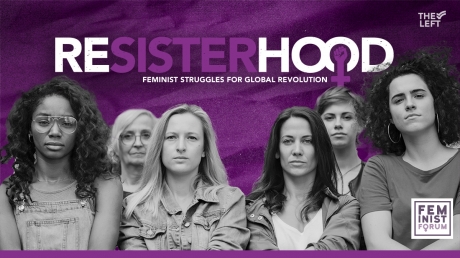Chaque matin, thé fumant à la main, Sylvie (1) s’assoit devant son ordinateur et entame sa «patrouille», comme on dit chez les «wikipédistes» aguerris. Prolifique contributrice, cette retraitée de l’éducation nationale vérifie que les pages dédiées à ses marottes n’ont pas été «vandalisées» dans la nuit, guettant les germes des «guerres d’édition» de demain. Puis, elle se rend sur le «Bistro», le forum des rédacteurs, et suit «le grand drama de Wikipédia».
Ces derniers mois, le cœur de la sexagénaire n’y est plus : trop de polémiques et des évolutions qui l’inquiètent. Le Bistro est désormais aussi agité qu’un plateau de débats télévisés. C’est pour ça qu’elle ne veut même pas qu’on donne son pseudo Wiki : «La moindre phrase y est décortiquée.» Sylvie n’aime pas le manichéisme mais voit se dessiner deux camps : «Les militants et les pépères.» Elle se range dans la seconde catégorie, «ceux qui fournissent le gros du travail !» Mais elle l’admet, il est fini le temps où s’investir dans Wikipédia était un hobby au mieux ignoré, au pire moqué.
L’encyclopédie collaborative est plus que jamais scrutée, critiquée, convoitée. Une citadelle en proie aux déchirements internes comme aux tentatives de manipulation externe, tant son influence est devenue prégnante. Pendant que les agences de com rivalisent de stratégies pour ripoliner les pages de leurs clients, l’extrême droite s’essaye à l’entrisme dans ce qu’ils appellent «Wokipédia». A l’inverse, des militants antiracistes et féministes dénoncent «un bruit de fond» réactionnaire dans les entrailles de l’encyclopédie. «Wikipédia est victime de son succès», conclut Sylvie.
Un méga-site d’actu
Victime, c’est à voir. Succès, c’est indéniable. Deux décennies après son lancement, la plateforme affiche une santé insolente. Cinquième site le plus consulté au monde avec 5,5 milliards de visiteurs uniques chaque mois et des dons en hausse constante, le drôle de projet de Jimmy Wales, entrepreneur de la Silicon Valley aux mœurs libertariennes (son premier coup dans la bulle internet était un site largement dédié aux photos X, qui financera l’ancêtre de Wikipédia), fait désormais figure de référence pour le grand public. Tant pour les personnalités vivantes, du despote octogénaire à l’actrice en vogue, que pour les plus obscurs événements historiques, le plus pointu des philosophes ou le plus exotique des coléoptères (sans compter le fichage exhaustif de tous les Pokémon).
Sur Google, peu importe la requête, l’article Wikipédia − parmi les 65 millions d’entrées existantes en 300 langues − est bien souvent le premier résultat. Retournement spectaculaire : dans les années 2000, lancer un «tu l’as lu sur Wikipédia» tenait du dénigrement, à l’époque où les fiches squelettiques étaient peu sourcées, méprisées par les universitaires, truffées d’erreurs ou de canulars. Désormais, cela vaut validation : si c’est sur Wikipédia, c’est sans doute vrai. Avec les enjeux − informationnels, réputationnels, démocratiques même − qui en découlent. Durant la pandémie du Covid-19, de nombreuses publications, y compris scientifiques, ont salué le travail contre la prolifération des fake news effectué par les wikipédistes, main dans la main avec les pouvoirs publics.
A l’échelle française, Wikipédia compte 30 millions de lecteurs par mois, ce qui en fait, au-delà de son statut encyclopédique, le site d’infos le plus lu de France. Car, loin de ses principes originels de recul, la plateforme s’est mise à coller à l’actualité en temps réel. Avec le risque de dérapages que cela induit. Deux exemples parlants : une longue page «Affaire Lola» a été échafaudée dans les quarante-huit heures suivant le meurtre de la jeune parisienne de 12 ans. Et lors des dernières législatives, un utilisateur s’est empressé d’amender la page de la députée insoumise à peine élue Rachel Keke, ex-femme de chambre, pour préciser : «Le soir de son élection, elle a des difficultés à s’exprimer en direct à la télévision.» Si l’ajout malintentionné a été supprimé rapidement, il illustre désormais le tempo à lequel sont soumis les gardiens du Wiki-temple, à l’heure où le moindre parlementaire a sa fiche. Au risque de transformer les contributeurs en faits-diversiers ou chroniqueurs politiques…
«L’actualité, on s’est fait un peu piéger là-dessus, constate Pierre-Yves Beaudouin, chargé du plaidoyer de Wikimédia France, l’un des “chapitres” de la fondation qui chapeaute le développement de l’encyclopédie. Le lecteur comme la communauté attendent désormais qu’on soit le plus à jour possible. Les audiences sont énormes sur les morts célèbres, les conflits en cours, les élections. Le décès d’Elizabeth II a fait doubler le trafic mondial de Wikipédia ! Cette responsabilité-là stresse un peu la communauté…»
Des shérifs
La communauté Wiki, c’est quoi au juste ? Est-ce le troll de passage, l’amateur éclairé, le rédacteur de niche, le pamphlétaire monomaniaque, le super geek aux dizaines de milliers d’interventions ? Qui fait Wikipédia ? En principe, n’importe qui avec une connexion internet. C’est le miracle participatif : le clapotis des ajouts, soustractions et corrections permanentes d’un océan de curieux produit une connaissance souvent plus solide qu’un comité de sachants. Mais dans les faits, certains contributeurs sont plus égaux que d’autres, pour paraphraser Orwell. Il s’agit des «administrateurs». Des bénévoles cooptés parmi les rédacteurs les plus actifs, dont la nomination se fait sous la forme d’un plébiscite public où chacun doit motiver son vote, fidèle au culte de la transparence logorrhéique de la plateforme. Avec leur étoile de shérif, les «admins» sont censés se dédier à la maintenance du site, à l’affût de toute «activité vandaloïde» (savoureux jargon wikipédien), épaulés par les «patrouilleurs» et des bots. Mais si les algorithmes dégomment aisément gros mots et pénis potaches, ils sont impuissants face au POV pushing (littéralement «point de vue forcé»), soit toute tentative de perversion du sacro-saint principe de neutralité.
Pour résoudre les disputes (elles aussi publiques, visibles dans l’onglet «discussion» de chaque article), les admins peuvent verrouiller ou supprimer des pages et bloquer les fauteurs de troubles. «On fait la police», résume «JohnNewton8», quadra bordelais qui se définit comme un cadre sup et ne veut surtout pas voir ses «outils techniques» comme un pouvoir. «On n’impose rien sur le fond, précise-t-il. On dit juste : “Mettez-vous d’accord, sans menaces, ni insultes, ni manipulation des sources, sinon on vous bloque.”» Environ 150 pour l’ensemble du Wikipédia francophone, dont le noyau dur compte entre 5 000 et 20 000 rédacteurs réguliers, ils ne sont qu’une trentaine à se colleter «les sujets chauds, compliqués, où ça ferraille sec». Qu’il s’agisse du conflit israélo-palestinien ou, plus étonnement, de l’huile d’argan (où se rejoue la brouille Maroc-Algérie), en passant par la vie et l’œuvre de Marlène Schiappa ou la fiche du bataillon ukrainien Azov (nazis ou pas ?)… «Ce qui bouge c’est la matière vivante, les conflits comme les personnes… L’article de Louis XI est stable», note JohnNewton8. Pour certains intronisés depuis une dizaine d’années, à l’instar de Jules, chauffeur de trains dans le civil et célébrité à l’échelle Wikipédia, ces admins postés sur la ligne de front essuient le feu des critiques.
De fait, derrière l’idéal d’horizontalité et d’autogestion, Wikipédia a accouché d’une sibylline hiérarchie prêtant aux comparaisons kafkaïennes éculées. Des blogs de révoltés en guerre contre «l’aristocratie wikipédienne» décrivent ainsi dans d’interminables posts «l’élection stalinienne» de tel admin ou l’aveuglement complice d’un autre, quitte à verser dans le doxxing, le déballage d’éléments intimes permettant d’identifier les quidams derrière les pseudos. Un véritable panier de crabes. Soupir de JohnNewton8 : «Facile de s’en prendre à nous : on prend les décisions qui fâchent. De là à imaginer qu’on est une clique ! On vient de tous bords, et on ne s’aime pas tous !» Jean-Noël Lafargue, enseignant en nouveaux médias et ex-admin tempère : «C’est un milieu où des gens ont quitté la communauté à cause d’une engueulade sur les chicons et les endives [le conflit sur le titre de la fiche dédiée à la chicorée dure depuis 2005, ndlr]. Les guerres d’édition génèrent beaucoup de frustration, mais comme tout organisme, Wikipédia a besoin d’anticorps…»
Pour «Sammyday», autre admin, «le niveau de violence n’est pas plus haut qu’avant, mais plus récurrent. Wikipédia est percuté par l’époque : le monde est plus polarisé, l’encyclopédie aussi. Tout devient épidermique». Au fil d’incessantes batailles plus ou moins futiles, la communauté a tenté de se trouver des arbitres. En vain. Les brigades de «Wikipompiers» ont été dissoutes et le Comité d’Arbitrage est en état de mort cérébrale, faute de volontaires. «On a un problème structurel d’absence de véritables médiateurs, concède Capucine-Marin Dubroca-Voisin, présidente de Wikimédia France. C’est un rôle dur, chronophage : plonger dans des discussions très longues, de façon écrite, et mettre sa réputation en jeu. Même quand on est admin, il est beaucoup moins risqué de faire du blocage de vandales dans son coin que de résoudre les conflits qui s’enveniment. Tout cela pèse sur la santé communautaire.»
Un loup zemmourien dans la bergerie
Ce climat délétère a été alimenté par une année 2022 émaillée d’«affaires» wikipédiennes. Il y a d’abord eu, en pleine campagne présidentielle, la révélation par Vincent Bresson, journaliste infiltré dans l’équipe de campagne d’Eric Zemmour, d’une cellule baptisée «WikiZédia», dont l’objectif était de lustrer les pages dédiées au polémiste, à son parti et à ses soutiens (l’enjeu n’était pas négligeable, la page Zemmour étant la plus visitée de France en 2021). Le groupuscule d’une dizaine de membres, chapeauté par Samuel Lafont, couteau suisse numérique de la fachosphère, s’appuyait sur «Cheep», pilier du Wikipédia francophone depuis une dizaine d’années. «C’était quasiment le plus gros contributeur de la partie politique, il jouissait d’une grande légitimité, moulé dans le style ultra-procédurier du site», raconte «Malaria28», bête noire de la bande WikiZédia, qui a depuis quitté la plateforme. Fort de son statut «autopatrolled», réservé aux gros contributeurs, Cheep voyait ses modifications validées automatiquement. Jusqu’à légender, en pleine polémique zemmourienne, une photo de Pétain et Laval en indiquant que leur «responsabilité dans la Shoah en France est sujette à débat». Si la grossière modification négationniste avait attiré l’attention, Cheep s’en était tiré avec un blâme, pas même un blocage. A la différence de Malaria28, aux interventions jugées trop virulentes.
«Le problème avec Cheep, c’est qu’il savait faire, explique JohnNewton8. Prises une par une, ses interventions étaient dans les clous, au regard de nos principes.» Au premier rang desquels, le «SBF» (supposez la bonne foi). En février, après la publication du livre de Bresson, Au cœur du Z, les administrateurs bannissent Cheep et six autres comptes. Sanction rarissime, à la hauteur du traumatisme, pour une communauté de fins limiers qui se vantait, jusqu’alors, de démasquer aisément «faux nez» et autres communicants masqués : il existe même une page sur le mode name and shame consacrée à toutes les tentatives d’«instrumentalisation et ripolinage de Wikipédia».
«Ce qui a été mal vécu, c’est que ça sorte dehors. On n’a pas su le voir, Cheep a su bénéficier de la mansuétude réservée aux anciens», reconnaît un admin. Pour ce dernier, Cheep n’était pas un cheval de Troie mais «un mec qui a retourné sa veste en reniant nos valeurs pour faire du militantisme. On accueille tout le monde, de la personne trans au vieux facho qui écrit des kilomètres sur Maurras − tant qu’ils s’en tiennent aux règles et aux sources». Wikimédia France a pris soin de préciser que le bannissement n’avait «rien à voir avec l’idéologie […] Cheep était notoirement connu pour être d’extrême droite», mais avec la violation d’une dizaine de commandements («neutralité», «savoir vivre», «conflit d’intérêts», utilisation de «pantins»).
Pris la main dans le sac, Lafont, le conseiller zemmouriste, hausse les épaules : «L’échec, il est de leur côté, pas du nôtre. Ils ont révélé à tout le monde qu’ils étaient une petite bande de militants. Qu’ils soient douze à faire la loi, on s’en fout. La question, c’est “est-ce qu’ils penchent d’un côté ?” Là, on l’a bien vu.» Dans une veine plus victimaire, Jean-Luc Coronel de Boissezon, ce professeur de droit révoqué par la fac de Montpellier pour avoir fait le coup de poing contre des manifestants étudiants en 2018, a réagi à l’exclusion de Cheep avec une tirade sur Twitter contre le «terrorisme intellectuel» que ferait régner sur l’encyclopédie «une poignée de geeks d’ultragauche haineux, caricaturaux, no life (sic) subventionnés». Au passage, Coronel de Boissezon, soupçonné de trafiquer sa page pour noyer sa condamnation à six mois de prison dans les tréfonds de sa notice, listait ses préconisations : «Ne jamais donner un centime [à Wikipédia]», «créer un compte et participer le plus fréquemment possible» et «encourager tout projet alternatif». Soit les deux grandes stratégies de la frange réactionnaire face à l’encyclopédie : l’entrisme ou la sécession.
Terre de croisades ?
Dans les sphères francophones, la première approche a été théorisée à l’aube des années 2010 par les sbires d’Alain Soral. Stéphane Condillac, le «monsieur Internet» du bretteur antisémite multicondamné, avait alors pondu un mode d’emploi pour une cellule d’une douzaine de personnes. Nombre «parfaitement suffisant […] [car] les débats contradictoires, voire les votes, mobilisent rarement plus de 10 ou 20 personnes», à condition de se plier à une «organisation très stricte voire militaire» pour tromper les administrateurs, «des geeks un peu flic». Plus récemment, on trouvait sur le site d’une officine catho-royaliste un appel reprenant ces consignes sous la bannière «Au nom de la vérité, investissons et conquérons Wikipédia !». Parmi les conseils, choisir «un pseudonyme discret, évitez les NouvelleCroisade et autres Vive-LouisXX» et faire ses preuves sur des sujets «non polémiques», type «bande dessinée, zoologie, l’église de votre village». Mais le but affiché était bien de peser, in fine, sur les pages les plus sensibles, comme celle consacrée à la théorie raciste du «grand remplacement». Cette dernière, champ de bataille permanent, a été placée depuis 2020 sous «semi-protection pour une durée indéfinie». En clair, les administrateurs ont posé un gros cadenas dessus, et sont désormais les seuls à pouvoir y intervenir. Un cas unique en français.
Il n’existe qu’un pays où l’infiltration droitière a fonctionné : la Croatie. Repérés par les médias locaux dès 2013, les biais ultranationalistes de cette déclinaison de l’encyclopédie étaient liés à la «mainmise d’un groupe qui a eu recours à des manœuvres d’intimidation et à des actions concertées pour acquérir du pouvoir au sein de la communauté wikipédienne», selon un rapport de la Fondation Wikimédia, publié en 2021. Il aura fallu près de dix ans pour que les membres de l’escadron, mené par un journaliste d’extrême droite, se voient privés des galons d’administrateurs qui leur permettaient de bloquer leurs opposants. «Aucune des différents Wikipédias n’est à l’abri d’une telle attaque», ont prévenu les analystes.
Les clones réacs, de «WikiKto» à «Conservapedia» aux Etats-Unis, ont quant à eux tous échoué, abandonnés faute de contributeurs ou macérant à l’état d’ébauche. «Faire son propre truc, ça ne marche jamais, concède Lafont. C’est comme dire, on va battre Amazon ! Faut être réaliste, ou avoir de sacrés moyens…» Dernière tentative en date, et pas des moindres : «Runiversalis», doublon de l’encyclopédie approuvé par les autorités russes fin août et «nettoyé» de toute mention de la guerre en Ukraine (fichée «Petite Russie»). Après avoir estimé que Wikipédia violait ses lois bâillons en colportant des «fake news de l’étranger», le Kremlin semble décidé à passer à la vitesse supérieure. Avant de bloquer l’accès à Wikipédia pour de bon ? Dans le doute, des utilisateurs ont commencé à en télécharger l’entièreté sur leurs disques durs…
La baston des sources
Sur Wikipédia, le nerf de la guerre, ce sont les sources. Et avec ce pivot inconscient vers l’actu chaude, celles-ci sont majoritairement journalistiques, loin de la vénération des thèses universitaires des débuts. Cette obsession de la «source secondaire fiable» (dans la philosophie Wikipédia, comme le veut un exemple célèbre, Philip Roth n’était pas une source d’autorité sur l’œuvre de Philip Roth, disqualifié comme une «source primaire») se frotte à l’épineuse définition de la neutralité des médias. «Un débat quotidien», confirme Jules, l’administrateur à l’origine de l’Observatoire des sources de la version française de Wikipédia, lancé en 2020. «Sur les pages liées au Covid et aux pseudosciences, le POV pushing était tout le temps lié aux mêmes sources, d’où l’idée de fixer la position majoritaire», justifie Sammyday. Ainsi, Valeurs actuelles n’est à utiliser qu’en «complément» et avec «proportion» (comprendre parcimonie), France Soir est un «blog complotiste» et Boulevard Voltaire «peu fiable». De l’autre côté du spectre, le Bondy Blog «est proche de revendications communautaristes musulmanes selon certains observateurs, tandis que d’autres sources y voient un média de qualité». Les médias «mainstream», dont Libération, ne font même pas partie de l’index, considérés de facto fiables. Fin septembre, c’était au tour des wikipédistes anglophones de décider si Fox News était une source acceptable. Au terme d’une discussion longue comme un roman (82 000 mots), un «consensus», valeur cardinale de l’encyclopédie, a été esquissé : les contenus liés au conglomérat ultraconservateur sont «marginalement fiables».
De quoi faire hurler les médias ostracisés, pour la plupart très à droite, qui reprennent en chœur les diatribes de Larry Sanger, éphémère cofondateur de Wikipédia. Véritable cerveau aux origines de l’encyclopédie (Jimmy Wales se chargeait plutôt de la partie tech), cet enseignant en philosophie a quitté le navire au bout d’un an, avant de lancer Citizendium, un anti-Wikipédia d’experts avec comité de lecture. Au fil des ans, Sanger a réécrit l’histoire, estimant avoir été évincé par «des anarchistes d’extrême gauche persuadés que [son] rôle [scientifique] posait problème». En 2021, sous les vivats de l’alt-right, il n’avait plus de mots assez durs contre son bébé. «Personne ne devrait faire confiance à Wikipédia !», tonnait-il dans le Daily Mail, déplorant qu’on ne pouvait plus y citer le tabloïd, ni Fox News : «Si une polémique n’apparaît pas dans les médias mainstream de centre gauche, elle n’apparaîtra pas dans Wikipédia.»
Conservateurs malgré eux ?
Mais les flèches pleuvent aussi depuis la gauche. Cet été, une dispute savante sur Wikipédia s’est retrouvée dans le Canard enchaîné. Bloqué définitivement sur le site, l’historien Damon Mayaffre, alias «Histors», assure avoir été victime des machinations d’un universitaire rival, le très conservateur Olivier Dard, qui sévirait sous le pseudo «Guise» (ce que le professeur à la Sorbonne, contacté par Libération, dément fermement). Tout commence sur une obscure page, celle des «Deux cents familles», en référence aux principaux actionnaires de la Banque de France jusqu’à sa nationalisation après-guerre. «Mythe politique» et «thèse complotiste», indique le résumé introductif de Wikipédia. Définition révisionniste et droitière, s’indigne Mayaffre, pour qui «un virulent débat intellectuel qu’on avait dans les années 70 à la fac s’est déplacé sur Wikipédia. Là, on traite Léon Blum de complotiste, quand même !» Pendant près de trois ans, ses modifications ont été systématiquement retoquées par l’hyperactif et influent Guise. Par dépit, Mayaffre-Histors multiplie les entorses à la wiki-étiquette : création d’un «Caou» (compte à objet unique) ; volonté de divulguer l’identité de son contradicteur ; utilisation de «faux nez» (avatars secondaires créés pour simuler des soutiens)… L’intéressé reconnaît des «maladresses» mais maintient qu’il s’agissait de collègues et étudiants : «Ils ont même bloqué l’adresse IP de l’université de Nice ! Quoi que je fasse, j’étais suspect parce que je n’avais pas leurs codes.» Ce que confirme à demi-mot un vétéran : «Entre Wikipédiens, on se tient les coudes, ça peut donner une impression sectaire vue de l’extérieur. Dans cette affaire, Histors avait peut-être raison sur le fond, mais il n’a pas su le prouver selon nos principes.» Symptomatique, opine un bibliothécaire sudiste récemment promu administrateur : «On a du mal à recruter et former des gros contributeurs qui ne soient pas là pour défendre une cause. Ces milieux ont progressivement fait leurs armes sur Wikipédia et en connaissent désormais tous les rouages. La situation se complique, je suis pessimiste…»
Cet automne, la charge contre le supposé conservatisme wikipédien a été nourrie par deux textes. Dans le numéro d’octobre de la Revue du crieur (éditions la Découverte-Mediapart), Sihame Assbague, figure clivante du combat contre les violences policières, dénonce le traitement réservé sur l’encyclopédie aux militants antiracistes, à l’instar de Rokhaya Diallo, dont les fiches seraient «des listes à la Prévert de commentaires critiques, […] de citations tronquées ou surinterprétées». Au même moment, l’Obs publie une tribune dénonçant «le traitement que réserve Wikipédia aux personnes trans, non binaires et intersexes», signée par le philosophe Paul B. Preciado, l’écrivaine Virginie Despentes et la réalisatrice Céline Sciamma. La discorde porte principalement sur le refus des wikipédistes d’utiliser l’écriture inclusive, actée lors d’un vote sans appel en 2020, et le maintien des «dead names» (prénoms pré-transition) dans les fiches concernées. La communauté peine à accoucher d’une convention sur la question, tiraillée entre son credo de «ne pas nuire» et son idéal d’exhaustivité. L’ambiance très «boys club» du Bistro, qui n’est pas modéré, est aussi pointée du doigt.
«Communautaires, les questions du langage épicène et du genre ont pris un certain relief depuis deux, trois ans, euphémise l’administratrice “Esprit Fugace”. On s’y heurte à l’un des obstacles majeurs que rencontrent ceux qui voudraient pousser Wikipédia sur un angle plus socialement libéral : les règles de Wikipédia imposent de respecter les sources, issues de la société. Si la société est biaisée (et elle l’est), alors Wikipédia va inévitablement refléter ce biais, en digne miroir qu’elle est. Corriger les biais sociaux sur Wikipédia revient à en faire un miroir déformant, ce qui prend à rebrousse-poil une partie assez importante des contributeurs.»
C’est pourtant dans ce sens que souhaite aller la Fondation Wikimédia, dans le cadre de sa «stratégie 2030». Théoriquement, la maison mère basée à San Francisco n’intervient pas sur la partie éditoriale, chargée seulement de lever les fonds nécessaires au fonctionnement de l’encyclopédie (hébergement des serveurs, codage de l’interface, relations institutionnelles). Mais, abreuvée de dons − déjà 150 millions de dollars collectés sur les trois premiers trimestres 2022, de quoi couvrir ses frais, auxquels s’ajoute un matelas de 100 millions sous forme de dotation − la fondation aide désormais des projets visant à rendre la plateforme plus diverse, tant dans ses contenus que ses contributeurs, comme «Noircir Wikipédia» ou «les sans pagEs». Créée en 2017, cette association francophone entend combler le manque de biographies féminines, qui représentent moins de 20 % du corpus. Durant l’été, elle a annoncé sa décision de se «professionnaliser», en salariant Natacha Rault, sa fondatrice. Si les sommes en jeu ne sont pas mirobolantes (30 000 euros de subventions par an), toute une frange wikipédienne y voit une dérive, une forme de POV pushing sponsorisé. Voire un conflit d’intérêts, Capucine-Marin Dubroca-Voisin étant à la fois présidente de Wikimédia France et trésorière des «sans pagEs». «Deux poids, deux mesures ?» feint de se demander le Figaro en osant un parallèle avec l’affaire WikiZédia. «Nous ne sommes pas payées pour créer des articles, comme une agence de com pourrait l’être», assure Natacha Rault, pour qui «le débat est très légitime, mais pas les attaques personnelles, ni le harcèlement». Son salaire, dit-elle, lui permettra de se dédier aux tâches administratives en soutien à ce projet qui mobilise environ 200 bénévoles et de nombreuses institutions culturelles. «Ces suspicions de “militantisme” omettent le fait que la connaissance libre est un acte militant en soi : Wikipédia, par définition, est révolutionnaire», souligne Dubroca-Voisin.
Wikipédia est-il un «miroir de la société» ou la boussole de l’époque ? Un arbitre impassible ou un agrégateur de polémiques ? La neutralité du savoir est-elle la neutralisation des luttes ? Le bénévolat est-il l’assurance de la probité ? Vastes débats. Les wikipédistes vont devoir trancher, quitte à verser des litres de jus de crâne. Ils y sont prêts.
(1) Le prénom a été changé.
.
.
.
.





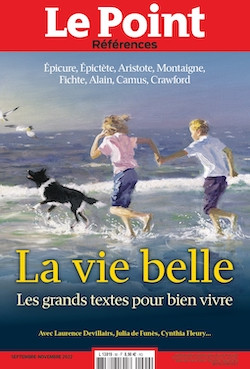
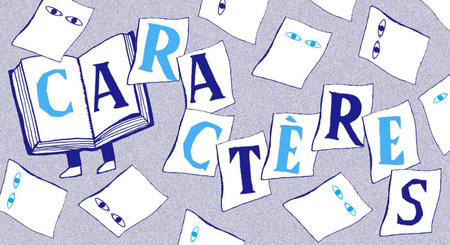
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/CV74SLBZ5RFFBPEBN2WQ7F3GYM.jpg)